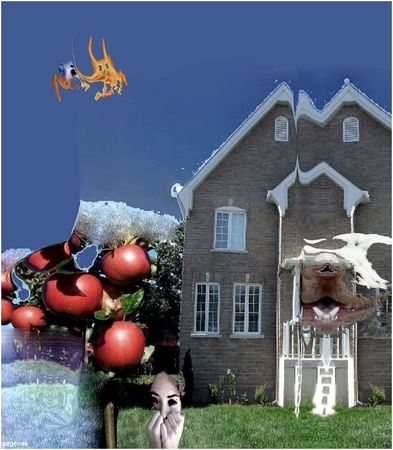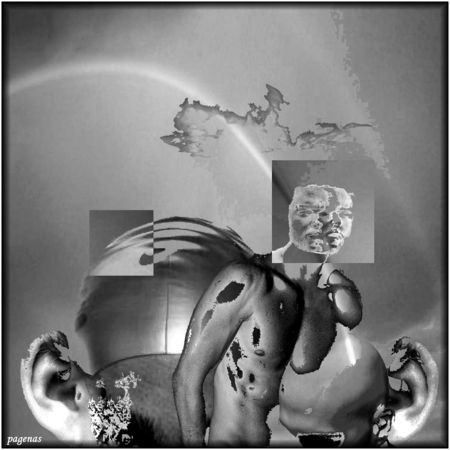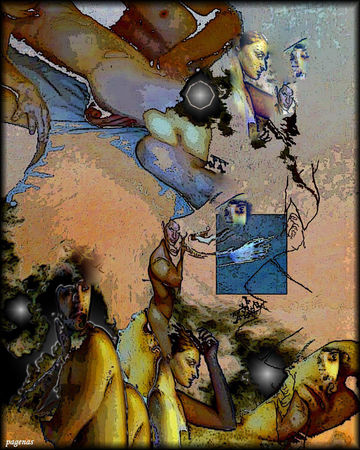Quand Sophie l’avait retrouvée au café de la Gare, la première chose qu’elle avait faite c’était de lui montrer la photo de classe. Une vieille photo de sixième où elle eut du mal à se reconnaître : cette godiche au deuxième rang, c’était elle ? Mon Dieu, quelle horreur, elle aurait préféré ne jamais se revoir. Puis Sophie lui montra le garçon du dernier rang :
- C’est lui !
- Alain Dutour ? fit-elle étonnée.
Elle se souvenait parfaitement d’Alain, elle en avait même été amoureuse. Ses cheveux châtains clairs et ses yeux verts lui avaient laissé un souvenir tenace. Et puis ce baiser, celui qu’il lui avait donné derrière la gare, c’était le premier, mais d’autres avaient suivi…
- Alain ? Tu es sûre qu’Alain aurait pu commettre ces actes barbares ?
- Oui, j’en suis sûre.
Sophie lui rappela que ses parents tenaient une ganterie à l’angle de la rue Rollon ce qui expliquerait…
- Oui, mais entre vendre des gants et couper des mains il y a de la marge.
Sophie se contenta de pleurer à chaudes larmes et finit par dire en hoquetant :
- C’est bien pour ça que j’ai fait appel à toi puisque maintenant tu es dans la police.
Sa logique la fit sourire. Il y avait quinze ans qu’elle n’avait pas revu Sophie. La dernière fois, c’était lors de leur soirée de beuverie juste après leurs études secondaires. Sophie était restée à Rouen et elle, elle était partie à Paris pour fuir l’air irrespirable de sa ville natale. Elle n’avait bien sûr dit à personne que ses parents l’avaient mise à la porte pour une stupide histoire de flirt consommé.
- Sophie, si tu pouvais m’expliquer les choses chronologiquement, ce serait mieux.
- Des mains ont été retrouvées dans des sacs poubelles, des mains qui appartenaient à des jeunes femmes, toutes ont été retrouvées mortes et elles avaient perdu leur main droite, sectionnée net ; je te dis que c’est lui.
Ce que Sophie oubliait de lui dire c’est qu’elle avait vécu avec Alain pendant trois ans, mais cela avait-il une incidence sur l’histoire qu’elle lui racontait ?
- Tu as des preuves de ce que tu avances ?
- Je le connais.
- Certes, mais encore ?
- Alain est fasciné par les mains de femmes.
- Oui, mais ça n’en fait pas un assassin quand même ! Qu’est-ce qu’il fait dans la vie ?
- Professeur de piano, dit-elle, et l’une de ces femmes avait des cours particulier avec lui.
Elle lui promit de l’aider en lui rappelant qu’une enquête avait déjà été menée et que le dossier était clos.
- Je peux garder la photo ? Lui dit-elle avant de partir. Je te la rendrai la semaine prochaine. Si j’ai quelque chose de nouveau, je te téléphonerai.
Cette semaine à Rouen promettait d’être particulièrement agitée. Elle descendit à l’hôtel de la cathédrale, le petit jardin intérieur et la chambre paisible la réconcilierait peut-être avec la ville. Elle irait voir ces parents dans deux jours et le lendemain elle téléphonerait à Alain. A quoi ressemblait-il maintenant ? A rien peut-être ? Une gentille bedaine et une calvitie naissante ? Elle réfléchit à ce qu’elle lui dirait pour éviter d’éveiller ses soupçons ; à vrai dire l’affaire était plus que récente et il avait sûrement entendu dire qu’elle travaillait dans la police.
Alain eut l’air surpris de son coup de téléphone, mais accepta de la recevoir chez lui le jour même. Il n’était pas tel qu’elle l’avait laissé en seconde mais elle le rangea tout de suite dans la catégorie « séduisant ». Il ne chercha pas vraiment à savoir le pourquoi de sa venue. Il lui parla de leur baiser derrière la gare – elle lui dit qu’elle s’en souvenait parfaitement – et plaisanta sur sa profession qu’il jugeait surprenante :
- Commissaire ? Si j’avais imaginé qu’une fille aussi séduisante que toi…
Elle ne releva pas et ils continuèrent à bavarder amicalement jusqu’au soir. Lorsqu’elle lui demanda s’il avait vu Sophie récemment, son visage se crispa légèrement et il répliqua :
- Sophie est très fragile. Elle a d’ailleurs fait plusieurs dépressions qui se sont terminées à l’hôpital psychiatrique.
- Ah bon ? fit-elle surprise, elle avait pourtant l’air équilibrée…
- Oui, l’air, mais il y a le fond…
Il lui proposa de rester manger avec lui, il pouvait parfaitement improviser quelque chose et il n’avait aucune obligation. Elle non plus. Elle lui proposa son aide, qu’il refusa, et pendant qu’il vaquait à la préparation du repas dans la cuisine elle fit le tour de la pièce. Le piano à queue trônait près de la fenêtre et la partition qu’il jouait s’intitulait : « les mains de la mer », d’un compositeur inconnu. Sur la cheminée poussiéreuse, quelques portraits de femmes et sur le minuscule secrétaire une lettre.
- Tu veux un apéritif ? lui dit-il de la cuisine.
- Je peux attendre ; je jette un coup d’œil à tes partitions, tu sais que moi aussi j’ai eu des cours de piano.
- Fais comme chez toi.
Elle revint vers le bureau et lut le début de la lettre rédigée pour une certaine Isabelle. Elle s’arrêta sur la dernière phrase : « je voudrais faire un moulage de ta main droite mais… ». Alain revint dans la salle et il lui fut difficile de cacher qu’elle lisait la lettre.
- C’est prêt, dit-il joyeusement. On mange dans la cuisine ? Je t’ai servi un verre de vin chilien, ça va te faire du bien.
Ils s’assirent face à face. Elle ne comprit pas vraiment pourquoi le vin allait lui faire du bien, mais elle ne lui en dit rien.
- Tu as des mains d’instrumentiste, de très belles mains élégantes, je serais presque jaloux....
- Mais de quoi ? répondit-elle l’air rêveuse. Au fait, tes parents avaient bien une ganterie ?
Il la regarda interloqué :
- Quelle mémoire !
- Oh, profession oblige, fit-elle négligemment.
- J’oubliais que pour toi tout est pièce à conviction. Au fait, je ne te l’ai pas demandé tout à l’heure, mas qu’est-ce qui t’amène ici ?
Alain la regardait d’un air qui lui parut suspicieux et elle se sentit obligée d’expliquer :
- Une vieille histoire avec mes parents, des choses à régler et puis j’ai revu Sophie, hier…
Il eut l’air surpris. Elle profita de ce léger avantage pour ajouter :
- Au fait, tu ne voulais pas reprendre la boutique de tes parents ?
Il lui sourit de façon désarmante et répliqua :
- Et toi, tu aurais voulu reprendre la boucherie familiale ?
Son visage se ferma instantanément, elle détestait entendre parler de ses parents et de leur boucherie. Il se leva pour aller chercher le plat qu’il avait mis au four et revint s’asseoir.
- Un reste de gratin de légumes.
Il emprisonna sa main droite dans la sienne et la retint longuement. Elle n’y fut pas insensible :
- J’étais très amoureux de toi tu sais. Dommage…
Pourquoi lui disait-il dommage, elle faillit le lui demander mais elle n’en eut pas le temps, le téléphone sonna et il se rendit au salon. Elle tendit l’oreille mais rien ne filtrait. Il revint au bout de quelques minutes :
- C’était Sophie, elle voulait savoir si tu étais là, je lui ai dit que non bien sûr, Sophie a une imagination débordante. Elle serait même capable de penser que cette petite soirée arrosée pourrait se terminer de façon plus intime.
Elle n’aima pas la façon presque évidente dont il le dit. Pensait-il réellement qu’elle allait coucher avec lui en souvenir du bon vieux temps ? Il énonça deux ou trois banalités, parla de ses parents à lui et à elle, de la boucherie, des souvenirs du collège, de ses années de conservatoire et à chaque fois qu’elle vidait son verre, il le remplissait. Le vin chilien faisait merveille, ses pommettes étaient en feux et la vie était aussi légère que la brume qui glissait sur la Seine. Il évoqua à nouveau leur amourette :
- Je me souviens encore de l’endroit exact où je t’ai embrassée la première fois, et toutes les fois suivantes.
Elle sourit :
- De l’eau a passé sous les ponts.
- Dommage ! dit-il à nouveau puis il ajouta, j’ai très envie de t’embrasser, je peux ?
Elle allait lui dire que non mais sa tête se fit lourde et heurta la table. Elle ne sut jamais ce qui s’était passé ce jour-là. Quand elle se réveilla après un cauchemar abominable où elle voyait sa main droite tranchée par une hache rutilante, elle vit une femme en blanc qui la sommait de se tenir tranquille. Elle regarda autour d’elle : c’était une pièce blanche, la fenêtre ouvrait sur un parc et il y avait le portrait d’une femme qu’elle ne connaissait pas sur sa table de nuit. Elle cria et demanda à la jeune femme en blanc qui entra dans sa chambre qui était cette femme sur la photo :
- Vous, madame, s’entendit-elle répondre.
Elle ne put contenir ses larmes. C’était elle ? Mais elle ne se reconnaissait pas du tout, ce n’était pas possible.
- Je veux voir mes parents.
- Ils sont morts, répondit l’infirmière, vous le savez bien. Le médecin recommande le calme le plus complet. Vous avez eu un choc émotionnel !
- Un choc, mais quel choc ?
- Je l’ignore madame, on ne m’a rien dit, le mieux c’est d’attendre la visite du médecin. Il passera à 16 h.
A 16 h pile, on frappa à sa chambre et le médecin entra. Son visage lui était familier. Elle le lui dit :
- Je suis votre médecin traitant, Madame Richard, le docteur Alain Dutour, vous me remettez ?
- Alain ?
Le docteur hocha la tête, l’air rassurant.
- C’est quoi ce choc dont m’a parlé l’infirmière ? Hier je mangeais chez vous et aujourd’hui je suis à la clinique ?
- Rien madame Richard, enfin presque rien. Ce matin vous avez reçu la visite du fils d’un ami à vous qui était professeur de piano à Rouen, et quand il vous a annoncé que son père était mort, vous vous êtes évanouie…
- Je me suis évanouie, moi ? Ecoutez, faites vite, il faudrait prévenir le commissariat, si on ne dit pas à mon chef ce qui m’est arrivé, il va me mener une vie impossible à mon retour.
Le docteur ne put s’empêcher de sourire :
- Ne vous en faites pas. Reposez-vous. Aujourd’hui vous prendrez votre repas du soir dans votre chambre, vous êtes trop faible pour aller dans la salle à manger.
Son visage se rembrunit soudain et elle demanda d’une voix blanche en regardant la photo :
- Docteur, répondez-moi franchement, j’ai quel âge ?
- 75 ans madame Richard, allez, reposez-vous et si ça ne va pas, appelez l’infirmière.
Il partit suivi de l’infirmière à la blouse blanche qui ressemblait tellement à Sophie, son amie d’enfance. La pauvre, elle se souvenait maintenant. On l’avait retrouvée morte chez elle, le corps dénudé, la main droite tranchée. Sa mort n’avait jamais été élucidée.